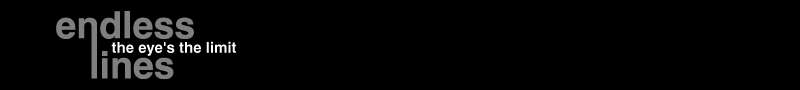| |
 |
|
Éric Gros:
exclusive interview 2006
CONTINUED FROM PART
1
Hawaï Surf : la diversification
C’est à quel moment que tu passes de "Skate
boarder’s house" à " Hawaï Surf " ?
Lorsque le skate commence à décliner, tous les autres
sports prenaient de l’importance et il fallait un nom plus
général.
Est-ce que le nom est un clin d’œil à Val Surf,
la célèbre boutique aux Etats-Unis ?
Pas du tout. C’est un voyage aux Etats-Unis. J’y allais
au moins une ou deux fois par an. Ça vient de mon attirance
pour le surf. Je me souviens de discussions le soir, de dessins
sur de petits bouts de papier et puis on en arrive au logo "Hawaï"
avec les vagues de partout !
Après le premier boum du skate, qu’a représenté
le marché du roller à cette époque ? Tu voyais
d’anciens skaters qui s’y mettaient ?
Il y avait très peu de personnes qui allaient de l’un
à l’autre. C’est plutôt des tribus qui s’agglutinaient.
Ça a toujours été soit l’un, soit l’autre
mais pas les deux !
Dans un autre registre, Est-ce que tu as vendu les premiers modèles
de snow-skate à la fin des années 70, les " Ski-Board "
que l’on montait sur un plateau de skate avec les trucks ?
Non. J’ai commencé par faire des snowboards que je
vendais en kit ! J’avais quelques " Wintersticks "
dans le magasin, mais ils étaient à nous. On ne vendait
que des planches " Hawaï " au départ.
Même pas " Burton ".
Et les premières marques de snow qui venait du skate comme
" Sims ", " Flite ", etc
?
Non, pas à ce moment-là. Par contre, j’ai acheté
un " Sims " dernièrement sur ebay, avec
les deux spatules en plastique. Et il s’est volatilisé
dans le transport !
À se demander s’il s’est vraiment perdu ou bien
s’il a été subtilisé… Il me reste
les photos de l’enchère sur ebay ! (Rires). C’était
un superbe Lonnie Toft, 10 pouces, un slick en dessous, une grosse
cuillère en plastique sous les trucks !
C’est donc le marché du snowboard et du windsurf
qui t’a permis de rester " à flot "
dans les années 80 ?
Oui, c’est le snow qui m’a permis d’être équilibré
entre l’été et l’hiver. Lorsque j’ai
commencé à prendre des salariés, je me suis
vite rendu compte qu’il fallait que je trouve un truc à
faire pour l’hiver ! La banque commençait à
me faire chier et il a fallu trouver des activités pour chaque
moment de l’année afin d’équilibrer le chiffre
d’affaires. Le snowboard, je me suis jeté dessus parce
que je n’avais rien pour l’hiver ! (Rires).
À quel moment passes-tu à de plus grosses boîtes
comme " Burton " ?
J’ai une facture d’eux, signée de la main de Jake,
qui date de 1982 ou 83…
Avant que V7 devienne un "empire", tu importais beaucoup
de marques ?
Jean-Marc, la première fois qu’il a voulu se lancer
dans ce business d’importation, il est venu me voir. C’était
le moment où il était pro chez " Tracker ",
il avait son modèle de planche. Il me dit : je vais
importer " Tracker ", qu’est-ce que tu
en penses ? Je lui ai répondu qu’avec cette seule
marque, ça allait être un peu juste pour vivre !
(Rires).
Pour en revenir aux importations, en France, à un moment
ou à un autre, on a été leaders. Peut-être
pas les premiers, car il y a toujours des magasins, à droite,
à gauche qui ont importé des produits sans qu’on
le sache forcément. Vu d’ici, tu crois être le
seul et puis en discutant avec des ricains, on s’aperçoit
qu’il y avait peut-être un mec à Carcassonne qui
a importé des trucs pour ses potes ! (Rires).
Toi, tu l’as fait à l’échelle de la France…
En fin de compte, ça vient de mon côté "sale
gosse" ! Je veux toujours et tout le temps de nouveaux
jouets. Donc, dès qu’il y a un nouveau truc, je saute
dessus !
La seconde vague
À quel moment sens-tu un frémissement de " reprise "
dans les années 80 ?
C’est comme pour la récession. Je n’ai pas vraiment
connu de mouvement brutal, ni dans un sens, ni dans l’autre…
As-tu vu des anciens skaters revenir dans ton magasin ou bien
était-ce une tout autre génération ?
-La population des skaters à ce moment-là était
déjà noyée au milieu d’autres types de
clientèle. Je n’étais plus dépendant du
seul marché du skate. Je crois que c’est ma capacité
à rebondir assez facilement et à anticiper… J’étais
tout le temps en train de chercher de nouveaux trucs : le frisbee,
le boomerang, etc. Ça partait dans tous les sens pour ne
pas avoir à dépendre d’un seul marché.
Dès qu’un truc baissait, il y avait autre chose qui
prenait le relais ! On ne s’occupait pas vraiment du passé
et on était déjà ailleurs le mois d’après !
Est-ce que tu te reconnaissais dans ces nouvelles attitudes ?
Étais-tu plutôt du côté " Skate
& Destroy " de Thrasher ou le " Skate and
Create " de Transworld ?
Je crois que toutes ces revendications étaient quand même
assez loin de nous, pour notre génération qui avait
connu la première explosion du skate. En tout cas, ce n’était
plus complètement mon truc…
" Vision " a apporté une ouverture à
un moment donné avec une image très marquée.
C’était un premier pas qui a ouvert de nouveaux marchés.
Pour moi, cela se situe plus à ce niveau-là. En ce
qui concerne la créativité, lorsque tu regardes ce
que faisais Wes Humpston à la fin des années 70, tu
t’aperçois qu’il n’y a pas eu de réelle
cassure comme certains le pensent. Il y des moments dans l’histoire
où c’est plus sous-jacent, underground, mais c’est
toujours présent parce que ça vient du côté
adolescent lié au skate. C’est une période où
tu refuses tout, la société, l’autorité
des parents, tu es toujours en train de faire le contraire de ce
que l’on te dit de faire ! Et sur les vieilles " Dogtown ",
il y a déjà les têtes de mort agressives que
l’on retrouve trente ans après sur d’autres boards !
Dans les années 80, lorsque les teams américains
venaient en France, est-ce qu’ils passaient chez toi ?
T’as eu la "Bones Brigade" ?
Non.
Santa Cruz lorsqu'ils filment pour "Street of fire“
?
On était malheureusement un peu en marge de ces tournées,
un peu en dehors de ce coup. On allait les voir sur les démos,
mais moi, sans avoir abandonné le skate, j’en faisais
beaucoup moins que dix ans auparavant… Là, c’était
vraiment une nouvelle génération qui arrivait.
Est-ce que tu sponsorisais des événements à
ce moment-là ?
Ouais, j’avais repris un team. Des jeunes qui montaient. On
a toujours eu 3, 4, 5 skaters qu’on aidait avec du matos, des
parutions, etc.
Des noms ?
Je n’ai plus de noms en tête, mais j’ai gardé
des photos !
Ta position dominante a été telle qu’il t’a
parfois été reproché de "diriger"
en sous-main, certains magazines comme " Surface mag ".
Avec le recul, comment analyses-tu ces rapports entre annonceurs
et rédacteurs ? As-tu l’impression d’avoir franchi
des limites ?
C’est difficile à mesurer car on était avant
tout une bande de potes. On montait les plans ensemble, notamment
avec Frédéric Michel. Mais ce n’était
pas une volonté particulière de pouvoir…
Est-ce qu’il y avait l’idée de soutenir un milieu ?
À l’époque, je ne me rendais pas compte que
je soutenais quoique ce soit… On formait une bande de potes.
On voulait rider, s’éclater ensemble. Au lieu de monter
des plans chacun dans notre coin, on se mettait ensemble avec un
photographe et on partait surfer les sablières, on partait
à la montagne, etc. On n’a pas changé nos manières
de vivre, on les a juste montrées à travers des vidéos,
des reportages, etc. Nous nous sommes retrouvés à
faire parfois des pubs pour des bagnoles, des produits qui n’avaient
rien à faire avec notre monde… Les gens nous contactaient
en nous demandant un surfer pour sauter au-dessus de n’importe
quoi ! (Rires).
Tu n’avais pas l’impression de franchir des limites ?
Ça allait loin parce que les relations entre nous étaient
tellement fortes que dans certains magazines, c’est vrai qu’entre
les pubs, les shoppings et les articles, il y avait du " Hawaï
Surf " partout !
D’où l’amalgame…
Fred Michel faisait " Surface Mag ". Jeff Lubrano
était le jeune qui arrivait et qui allait faire les " Noway ",
" B-side ", " Planche Mag ",
etc. Ce que je veux dire par là, c’est qu’il y
a toujours un plus petit qui arrive, qui prend la relève
et c’est ce qui a fait que l’on a toujours eu un pote
dans la presse. Mais ce n’était pas pour autant un mec
acheté ! Maintenant, lorsque l’on regarde avec
du recul, on peut trouver ça effarant ! (Rires). Ce
qu’il faut ajouter également, c’est qu’on
payait la publicité, ce n’était pas un cadeau,
il n’y avait pas d’appointements particuliers avec nos
annonces.
Comment as-tu vu l’arrivée de Steve Rocco dans l’industrie ?
Est-ce que tu a été sensible à cette prise
de pouvoir ?
Au départ, je trouvais ça assez positif. Mais il
est allé rapidement trop loin… Les fausses pubs avec
les roulements suisses nazis, comment se suicider… Les barrières
que certains avaient renversées restaient "gentilles",
Rocco les dépassait avec comme moteur, l’argent de sa
"World company". C’est la première fois qu’une
marque m’a définitivement fait revenir en arrière…
Il a expérimenté des stratégies marketing
très offensives, avec parfois, beaucoup de pression sur les
shops. Est-ce que tu as ressenti ça à ton niveau en
France ?
Pas comme ça. Mais cette mainmise sur tout était
vraiment "too much". Qu’un skater dépasse
à ce point les bornes pour bâtir un empire financier
qui brasse des sommes colossales… Au secours ! En réaction,
j’ai été attiré par des plus petites marques,
des gens qui étaient plus en phase avec ce que je fais.
Son attitude a-t-elle fait des émules dans le business
français ?
-Pas vraiment. À un moment donné, " Templar "
a fait quelques belles conneries ! (Rires). Des copies de " Tracker "
à Taïwan ! Ce genre de trucs n’est pas bien
passé…
Tu nous disais que J. -M. Vaissette vient te voir lorsqu’il
commence à distribuer "Tracker ", est-ce
que P. -A. Senizergues te demande également conseil au début
de " Etnics " ?
J’avais moins de rapports de proximité avec lui, il
était plus distant, plus réservé… On s’est
bien sûr suivi mais j’étais moins proche de lui
que de Jean-Marc.
Le freestyle, c’est finalement une bonne école pour
le business du skate, non ?
Je ne suis pas sûr que ce soit la pratique qui ai fait ça…
C’était des besogneux. Il fallait les voir travailler
sans arrêt leurs figures. On se disait en regardant ça :
ils sont malades ! (Rires). Nous, il fallait que le skate soit
facile et immédiat ! On n’avait pas cette notion
d’entraînement, bosser les flips, les rotations, etc.
Je crois que c’est plus cet aspect de leur personnalité
qui a fait qu’ils sont arrivés à quelque chose.
Ils se sont intéressés au freestyle pour ces raisons
et ils continuent, aujourd’hui dans leur business, de bosser
du matin au soir !
Les publicités
Je voudrais justement que l’on parle un peu de tes publicités.
Dès le début, une de tes marques de fabrique a été
de proposer des publicités vite reconnaissables, dont l‘intérêt
dépassait la seule information. Qu’est-ce qui t’avait
fait prendre conscience de l’importance que l’image jouait
dans ce milieu ?
Je ne suis pas sûr d’avoir eu conscience de tout cela…
Pour faire venir du monde à Ivry, j’étais plus
ou moins obligé d’en passer par la pub dans le presse.
À la base, j’étais comme tout le monde, en admiration
devant les publicités américaines et donc j’essayais,
non pas de copier, mais de m’inspirer de ce qu’ils faisaient
pour le faire "à la française".
Il y a dans ces publicités, un côté "professionnel"
que l’on ne voyait pas en France. Tu attrapes ça assez
rapidement…
À l’époque, notre référence était
bien évidemment les publicités " Val Surf ", c’était
notre repère.
Comment les concevais-tu techniquement ?
Allais-tu dans un studio de photographe, ou bien est-ce que ça
se faisait dans un coin de ton magasin ?
Il y a eu plusieurs options. Les premières pleines pages
avec les skates ont été faites dans un studio dans
lequel on posait tout le matos par terre. On reconstituait la page
avec un cadre que l’on avait déterminé à
l’avance au sol. On composait tout sur cette surface pour faire
la photo.
Ensuite, je faisais les montages à l’avance avec des
photocopies découpées et collées. Mais je me
suis vite rendu compte qu’il fallait ensuite faire un scan
pour chaque planche et lorsque tu en as une cinquantaine, ça
faisait une grosse somme. À l’époque, je payais
"au scan" et ça coûtait un petite fortune !
Donc, il fallait trouver autre chose et on s’est remis à
faire une seule photo d’ensemble avec tout le matériel.
On installait les planches, les pompes, les tee-shirts, les vidéos,
etc. La page était montée par terre. On louait le
studio d’un photographe chez qui on installait tout et ça
nous coûtait finalement beaucoup moins cher que de faire les
montages de scans.
Tu as des documents sur ces séances ? Les mises en
scène dans le studio ?
Non. Après cette étape, on en est arrivé à
concevoir une boîte à lumière géante !
Pour éviter d’avoir des ombres portées sur le
sol, on avait construit cette boîte au format homothétique
de la page imprimée et on l’éclairait par-dessous !
Ce travail payait parce qu’on passait souvent plus de temps
à regarder ces pages qu’à lire les articles !
(Rires).
Au départ, lorsque je voyais les pubs " Val Surf ",
je restais aussi deux plombes dessus. J’ai reproduit ça
et forcément les mômes aimaient la même chose.
On a fait un coffre à jouet, géant…
Dans ton chiffre d’affaire des années 80, la vente
par correspondance représente-t-elle une grosse part ?
Non, pas vraiment. J’avais simplement une personne derrière
qui s’occupait des commandes, mais ça n’a jamais
été l’explosion.
À partir de quel moment as-tu cessé de passer des
publicités dans la presse skate ?
Il fallait élargir. C’était une question vitale
pour nous. Donc, après avoir passé beaucoup de pub
dans peu de supports, nous avons essayé des ouvertures vers
d’autres publications de la presse généraliste
dite "jeune". J’ai pris un attaché de presse
et on est même allé prospecter vers le "grand
public", comme " VSD " ou " Paris-Match ".
Le principe était d’aller trouver les parents ou bien
les gens qui avaient envie d’y venir sans avoir forcément
des repères…
Quelle est pour toi, la marque de skate qui a fait la meilleure
campagne de pub ?
-Définitivement les premières pubs " Alva " !
Cette décadence dans son attitude, ses cheveux longs, son
chapeau, la planche tendue à bout de bras ! J’ai
une série de photos où j’essaye de lui ressembler,
avec le chapeau et les cheveux longs… (Rires).
Il y avait des petits Alva partout ! Dans un " Skateboarder ",
il avait trouvé un Alva black à Londres ! (Rires).
Il était en décalage avec pas mal de trucs. C’était
souvent n’importe quoi, mais ça marchait parce que c’était
tout ce qu’on aurait voulu faire sans oser le faire… Il
nous a deshinibé !
Un patrimoine
Après toutes ces années, comment te sens-tu par
rapport au milieu du skate parisien ?
On s’est progressivement dégagé de ce marché
pour plusieurs raisons. D’abord, le skate n’est plus rentable
commercialement. Lorsque tu vends une planche à 70/90 €
et que ta marge n’est même pas de deux… Une paire
de roller, à côté, coûte quand même
300/400 € ! Ça, c’est une réalité
commerciale. Tu achètes un surf, une planche à voile
pour 2/3 ans alors qu’un skate, c’est pour 2/3 mois. Les
boards sont devenues un consommable de plus, comme une cartouche
d’imprimante…
Ensuite, je m’étais également rendu compte que
ces skaters qui passaient la journée au shop, comme à
" Street Machine " qui était un de mes
concurrents à une époque, restaient des heures à
zoner, regarder des vidéos, sans faire tourner le magasin…
Cette situation pouvait même repousser des mamans qui voulaient
entrer pour acheter un skate à leur gosse qui se la pétait !
Est-ce que ta position " excentrée "
t’as tenu à l’écart de certains phénomènes
de mode ?
Je crois que c’est plutôt des situations de business
qui m’ont toujours fait avancer, poussé à anticiper
les choses et à trouver les nouveautés avant qu’elles
se développent. Que cela soit pour les chaussures à
roulettes, les trottinettes, etc.
Tu choisis quand même celles qui marchent le mieux !
Bien sûr. Avant de rentrer un produit, nous sommes les premiers
à l’essayer. J’ai gardé cette exigence de
môme qui veut toujours le plus beau jouet ! Le côté
"sale gosse" dont je parlais tout à l’heure…
La patinette, ça m’a saoulé de le faire, mais
lorsque tu as 20 mecs par jour qui te demandent ce produit, tu te
plies.
Tu vois un nouveau truc qui se profile ?
Plus rien ! Aujourd’hui, c’est le cross-over dans
tous les sens. On a écrit et défriché les bases
de la glisse. Une des différences par rapport aux décennies
précédentes, c’est qu’il n’y a plus
de tribus aussi marquées. Les mômes font du surf l’été,
du snow l’hiver, du skate en ville, tout se mélange.
" DC " fait une traversée avec des bagnoles !
Tous ces sports référencent maintenant une manière
de vivre, de bosser et de consommer.
Notre génération a été le témoin
de ce changement…
Elle ne l’a pas seulement vécu, elle l’a imposé
et écrit. On a définitivement crédibilisé,
testé ces modes de vie. Je me souviens de la première
fois que je vais chez mon banquier pour ouvrir un compte avec mes
cheveux longs et mon look, le mec derrière le comptoir m’a
demandé si j’étais le coursier ! (Rires).
Aujourd’hui, je ne vais même plus le voir, je représente
10% de son chiffre d’affaire et c’est lui qui se déplace !
Si tu avais à monter une " Dream team/Hawaï
Surf ", tu prendrais qui, toutes époques confondues
?
La "Dream team" qui me fait vibrer, ce sont mes potes.
Les vendeurs du magasin que je recrute, avec qui que je pars en
week-end. On vient de rentrer du Mondial du ski et le week-end d’avant,
c’était celui du snow ! À huit heures du
soir, on prend deux "Espace" et on part à dix.
On arrive à deux heures du mat’ pour rider deux jours.
Et sur ces deux jours, il y a un jour où il pleut !
Les virées en célibataires !
On est resté adolescent et de ce point de vue, on ne veut
surtout pas être adulte. Ceux qu’on a pu connaître
nous ont suffisamment cassé les couilles pour qu’on
ne reproduise pas ça !
Nos parents ont connu la guerre, même de loin, ça les
a cassés d’une certaine manière et notre génération
n’a pas voulu devenir comme ça…
Tu n’a jamais fabriqué de planche de skate " Hawaï
Surf ". Pourquoi ? Ce n’est pourtant pas les propositions
qui ont dû manquer…
J’ai toujours fait les jouets que je ne peux pas avoir, et
les skates, je n’en ai jamais manqué ! (Rires).
Les snowboards que j’ai fabriqués, c’est parce
qu’il n’y en avait pas sur le marché ! Ensuite,
lorsque les bons produits arrivent de manière industrielle,
je ne vais pas me faire chier à les fabriquer… Ce n’est
pas mon but. Moi, je vends ! (Rires). Les skates, il y a tellement
de gens qui en font que je ne vois pas l’intérêt.
Mais tu as été approché ?
Moi, une planche " Hawaï ", ça
ne me fait pas rêver. Et je me mets à la place des
mômes, quitte à acheter une planche pas chère,
je préfère de loin une nude… Je n’ai pas
le narcissisme de mettre mon nom systématiquement partout !
Mon but est d’avoir le plus beau jouet sous les pieds…
Tu as d’ailleurs une des plus belles collection de skate
et de surf en France. Ta plus belle pièce en skate, qu’est-ce
que c’est ?
Ma fausse " Dogtown " que j’ai peinte !
(Rires). Je craquais sur ces planches qui n’étaient
pas encore disponibles en France et j’ai donc pris une photo
avec laquelle j’ai bricolé la déco : sur
le haut, la croix " Dogtown ", et le nom " Alva ",
en bas. Ça ne ressemble à rien ! Un jour, il
faut que je l’envoie à Wes Humpston…
Tu la lui fait authentifier ! (Rires).
En surf par contre, c’est une planche que j’ai achetée
il n’y a pas très longtemps. Elle date des années
30. C’est un paddle que je voulais depuis très longtemps…
Je l’ai payée une fortune, maintenant que j’ai
un peu les moyens ! (Rires). Ce n’est même pas une
planche de surf, c’est l’ancêtre du surf, un objet
rare en contre-plaqué, comme celles que l’on voit derrière
le Duke…
Tu es constamment en recherche ?
Tous les jours ! Le soir, avant de partir du magasin, je jette
un coup d’œil sur ebay… J’achète en permanence.
Lorsque tu mets en ligne des modèles des années
70 et 80 sur ton site, qu’est-ce que tu recherches ? Tu
veux tester le marché français ? Qu’est-ce
que ça représente en volume ?
Même pas une planche par semaine ! C’est une manière
de faire un clin d’œil à l’histoire. Par amour
et par passion. Ces planches ont marqué une époque.
Pour en acheter, c’est quand même assez difficile, il
faut passer beaucoup de temps sur ebay, connaître les côtes,
les pièges. Avec le net, je mets ces planches à la
portée de tout le monde.
Cela dit, je me rends compte que je suis en décalage. Dernièrement,
je suis allé "faire du shopping" avec mon équipe,
chez Vaissette. Je leur ai apporté une dizaine de plateaux
" Banzaï " pour leur faire plaisir et les
trois-quarts voulaient la monter pour la rider ! Je leur ai
dit de les garder, mais ils en n’ont rien à foutre !
(Rires). Même Jean-Marc, le peu de planches collectors qu’il
a, c’est moi qui les lui ai données ! Il n’a
rien gardé ! Il n’a pas du tout cette recherche
de l’histoire… Je suis toujours surpris de ça.
Moi, c’est vraiment le contraire, je stocke sans savoir ce
que je vais en faire ! J’en ai des wagons, des caves entières…
Heureusement que je commence un peu à "dégraisser".
J’ai deux ou trois potes avec lesquels je deale, "Djoldskull"
par exemple avec qui je suis régulièrement "en
affaire".
Quelle est le skate que tu as le plus vendu ?
La Natas Kaupas, avec la panthère noire. À une époque,
on faisait des pubs, des quarts de page, seulement avec cette board !
Et la Warptail ou la Gator ?
Pas au niveau de la Natas. Il y a eu plusieurs générations
de Natas, avec la panthère, le chat… Pendant un an ou
deux, on a fait de la communication sur cette planche. Et le meilleur,
c’est que je n’en ai même pas gardé une !
Je viens de racheter un modèle, 150 €, pourrie…
(Rires). J’aimerais bien avoir la collection complète.
As-tu une idée de l’endroit le plus improbable où
tu aies expédié un skate ?
Le plus improbable, c’est de vendre maintenant via le net,
des planches " Banzaï " aux Etats-Unis !
(Rires). Ou de leur revendre des produits qu’ils ont importés
en France. C’est un beau pied de nez ! Il n’y a pas
très longtemps, j’ai ramené quelques " Bad
Boy Club " à Jim Muir, à Bill Danforth.
Ils n’en croyaient pas leurs yeux… Ils avaient l’impression
que c’était des copies, qu’elles sortaient de la
presse !
Le film " Dogtown " semble t’avoir marqué,
qu’est-ce que tu en as pensé ?
C’est ma jeunesse. La première fois que j’ai vu
le documentaire, en Allemagne, j’avais la chair de poule, j’en
ai presque chialé… Le film est bien parce que ce sont
de belles images, il y a une histoire arrangée, bien foutue.
Je trouve qu’il reflète bien la mentalité de
l’époque. Ça aurait vraiment pu être pire…
Au niveau des ventes, après le film, as-tu ressenti un
frémissement, une demande particulière ?
J’ai tout fait pour. Des rayons " Dogtown ",
mais rien n’est venu. Personne n’a compris… Les jeunes
qui font du skate aujourd’hui, n’en ont rien à
foutre de " Dogtown ", pour eux, c’est
la préhistoire. On a cru que cela allait relancer la demande
mais il n’y a rien eu. Et c’est normal, il y a 3 générations
de skaters entre " Dogtown " et aujourd’hui…
Tu sais, même lorsque Natas est venu à Marseille
il y a deux ans, peindre le bowl, les gamins se demandaient quel
était ce vieux aux cheveux longs qui les empêchait
de skater, alors " Dogtown "…
Nous, on fait un peu d’archéologie !
Novembre 2005, propos
recueillis par C. Queyrel.
(Toute reproduction, même partielle, est interdite sauf autorisation)
|
|