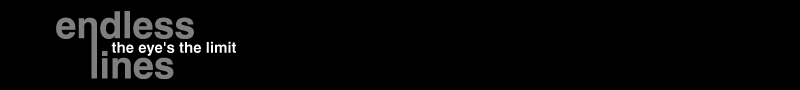| |
Esprit,
n°10, octobre 1978
|
|
page 27
FIGURES URBAINES DU QUOTIDIEN
La publication de ces trois textes risque de surprendre des lecteurs habitués à une approche des phénomènes culturels plus classiques. D'autres croiront que nous sacrifions aux exigences de modes passagères qui rythment la culture du temps. Pourtant notre désir est tout autre : il s'agirait plutôt de percevoir à travers certaines manifestations culturelles et sociales - l'évolution de la musique rock, le phénomène punk, la vague du skate-board - quelques «points de repère » permettant de mieux saisir les métamorphoses - par ailleurs peu visibles - de la société contemporaine. Ainsi on sera peut-être frappé par la convergence de ces textes sur un point celui du retour au quotidien, du retour à la ville et à la rue (comme le dit Bernard Lavilliers : « On n'est pas d'un pays mais on est d'une ville I Où la rue artérielle limite le décor.»); le temps n'est plus celui du retour aux sources, à la terre, aux communautés, celui de la plongée dans l'imaginaire, celui du rêve, dont le mouvement hippy apparaît après coup comme la figure de légende.
Les formes musicales les moins « artistiques», la façon dont les jeunes se rapportent à leur corps, contribuent avec peut-être plus de pertinence que des modes de représentation culturelle traditionnelle - roman, théâtre, cinéma... - à faire comprendre certains mouvements souterrains de la société.
C'est dire que le culturel n'est jamais réductible aux seules sphères de la culture instituée, qu'elle soit élitiste ou non d'ailleurs.
LE ROCK : UNE MUSIQUE POUR LE PRÉSENT
Pour qui refuse la « culture-supermarché » qui voit l'individu dépossédé, livré aux fabrications et aux manipulations de la mode, de la publicité, il peut paraître paradoxal de s'intéresser à la « musique pop » : « Rock-Coca-Cola », écrasement des cultures nationales par une musique fabriquée outre-Atlantique, succession de plus en plus rapide de modes insignifiantes, consommation passive de disques, toujours croissante, inquiétant face-à-face de la « star » et de son public… Ghetto d'une jeunesse uniformisée, atomisée, assourdie, transformée en créneau commercial, mise à l'écart et ainsi dominée avec sûreté par l'organisation de son « évasion » dans l'insignifiant ?
S'agit-il même d'une musique ou bien d'un simple produit conçu artificiellement, froidement, à l'extérieur de toute vie commune, ne serait-ce que la vie d'un groupe : musique de studio, électronique (le disco par exemple) ?
Pourtant, constamment abâtardi, aseptisé, standardisé par l'industrie du spectacle, le rock retrouve, non moins obstinément, sa forme primaire, élémentaire, brute là où choisissent toujours de s'affirmer de manière privilégiée l'identité et la révolte adolescentes. Comme s'il y avait là quelque chose d'essentiel à se réapproprier pour la jeunesse urbaine occidentale (et au-delà). De nombreux groupes se forment, une littérature apparaît (fanzines), de petits labels indépendants de disques se créent, une scène se constitue, souvent en butte à des difficultés administratives, à défaut, un curieux espace privé-public, les caves des fameux « garage-bands ».
Un tel mouvement apparaît à nouveau avec ce que l'on a appelé le « punk » ou la « new wave », singulièrement en Angleterre mais aussi en France. Les années 70 avaient vu s'établir une musique élaborée, sophistiquée, plaisante, agréable, créant une ambiance propre à la rêverie, à l'évasion, parfois au grand « voyage » cosmique (rock « planant ») dans l'utopie d'harmonie universelle et d'amour qu'imaginaient les « hippies ». Avec la vague «punk », la jeunesse se réveille brutalement de son sommeil utopique : le réel le plus brut fait irruption avec violence. Quelque chose qui peut s'apparenter à ce qu'a représenté pour certains intellectuels la découverte de la réalité (le Goulag…) effondrement des illusions, des mythes, des utopies. Avec des significations, des enjeux, des rythmes propres, même si parfois ils se rejoignent, ces mouvements ont quelque chose d'analogue. Ce qui témoigne immédiatement de leur importance : quelque chose d'essentiel pour notre société s'y joue, au-delà de la mode, intellectuelle ou musicale. Nous sommes rendus, comme le dit Michel Foucault, à un « réel aigu, âpre, anguleux, inacceptable (1)».
D'abord un refus, celui des belles phrases, des beaux discours, des belles mélodies : autant d'évasions, de spectacles, de représentations trompeuses qui font écran à la réalité, l'adoucissent et, insidieusement la justifient, alors même qu'elles prétendent souvent la contester. Il faut commencer par les détruire : les « Residents » (groupe de San Francisco) font systématiquement éclater les jolies mélodies des années 60... un peu comme les lycéens, ou certains jeunes ouvriers ont pu remplacer dans leurs manifestations les slogans par des hurlements. La musique se présente alors sous sa forme la plus brute, non mélodique, non discursive (les textes importent peu et figurent rarement sur la pochette du disque, contrairement à une habitude qui s'était instaurée), directement expressive de notre réalité quotidienne, urbaine, industrielle : rythmique violente, mécanique, répétitive, hurlements de l'électricité et des machines électroniques.
Se montrer aussi soi-même, tel que l'on est : on délaisse les jolis vêtements exotiques qu'affectionnaient les « hippies », on se coupe les cheveux pour se regarder dans sa nudité, même si elle est laide. Elvis Costello, nouvelle gloire du rock anglais, se présente comme un petit employé de bureau très ordinaire, Ian Dury est infirme. Le groupe « Devo » (Akron, Ohio) glorifie le monstrueux (« Mongoloïd »). Les «vedettes» sont quotidiennes, les stars mythiques ont disparu, leur nostalgie est violemment repoussée. Dans leurs interviews, les groupes « punk » expriment souvent cette volonté : renvoyer aux gens l'image de leur réalité quotidienne (Johnny Rotten des « Sex Pistols», « Devo »...).
Détruire donc, mais pour retrouver le réel, le présent : en quoi la violence musicale « punk » n'a rien à voir avec la violence terroriste. Se défaire des représentations qui occultent la réalité présente, c'est aussi bien se débarrasser de la vision nostalgique du passé ou d'un « ailleurs » que de la représentation d'un futur utopique, de lendemains enchanteurs. « Je ne sais pas ce que je veux», chante Johnny Rotten : «No future». La musique rock sera simplement la musique du présent, une musique moderne, la musique du monde des machines, des ordinateurs. Les instruments électroniques ne serviront plus à projeter l'auditeur dans un grand voyage cosmique dans le futur : ils manifesteront au contraire bruyamment leur présence obsédante, oppressive, brisant les mélodies, déformant la voix humaine ou même la synthétisant, développant des rythmes mécaniques, lancinants, froids (groupes américains : Devo, Père Ubu, Suicide, et allemands : Kraftwerk...).
Aucun refuge donc, ni dans le passé, ni dans un futur qu'on se refuse à rêver ou à imaginer en vertu d'un quelconque sens de l'histoire. De quoi incliner au pessimisme, au nihilisme. Point zéro... mais à partir duquel on est rendu au réel, à partir duquel il peut à nouveau être question d'agir, d'inventer.
Car, retourner au réel, c'est déjà témoigner de sa capacité, de sa puissance à affronter la réalité, le présent le plus dur. Ce qui se découvre ici en même temps, c'est l'énergie, terme-clé du rock : ce que l'on attend de lui en premier lieu.
L'énergie, c'est d'abord cette force immense requise pour s'arracher aux rêves, à la fuite, à la nostalgie, aux mythes sécurisants. Dans le rock, la jeunesse puise la force de regarder la réalité ; de se regarder aussi : c'est sa propre force, son identité collective qu'elle retrouve et affirme. Joie de se retrouver ensemble dans le même espace public (concerts…), dans un réseau où, sur le fond de la communauté (modes de comportement : bière…, modes vestimentaires toujours renouvelées… ), chacun échange les signes de sa différence, portant en « badge » le nom de tel ou tel groupe impliquant des significations spécifiques. Affirmation de soi, rupture avec le passé : le groupe anglais Generation X parodie un succès des années 60, « My generation » en chantant « Your generation ». Les Lyonnais de Starshooter proclament : « Nous haïssons les Beatles ».
La positivité du rock, c'est cette capacité - l'énergie - qu'il donne d'éprouver la réalité nue, sa propre réalité, de refuser les sécurités illusoires et anesthésiantes, de ne pas céder au besoin de recouvrir le présent par le passé ou l'avenir : de s'ouvrir au présent.
Épreuve incontournable : avant toute autre chose, il faut ressentir l'ouverture du présent, c'est-à-dire la possibilité d'y vivre, d'y agir, de le transformer. Ceci n'est plus immédiatement donné et la société se présente souvent à la jeunesse comme une mécanique qui ne laisse d'autre choix que de s'y insérer, nouvelle pièce de la machine, au prix de se perdre, ou de la fuir. Est-il encore possible d'agir, ici et maintenant, dans notre société, dans nos villes ? Le rock donne la preuve que quelque chose peut se faire. À partir de notre présent, en reprenant les éléments mêmes de notre modernité, les machines, sans fuir ailleurs, quelque chose peut se construire, s'organiser : de la musique. Et chacun peut le faire sans technique musicale approfondie : ce sont les premiers spectateurs des Sex Pistols qui vont former, selon le voeu même de Johnny Rotten, les nombreux groupes de la vague « punk » en Angleterre.
Avec l'électricité, l'électronique, les machines, le bruit urbain, faire de la musique. Se mettre à jouir de ces réalités dures, insupportables, puisqu'il s'agit, avant tout, en jouant, de prendre du plaisir. Là se joue l'opération essentielle de l’« alchimie » rock n'rollienne : la « transmutation » du moderne. « Nous sommes les fleurs dans la poubelle » dit Johnny Rotten. D'instruments de torture, les machines modernes apparaissent instruments de jouissance. Il y a une fascination essentielle dans le rock pour les machines. Mais, encore une fois, il ne s'agit pas de rêver de machines idéales, harmonieuses car alors, le rock s'affadit et se perd. Le rock renaît en faisant jouer nos machines, celles de notre présent, celles qui nous écorchent l'oreille. Pas question d'adoucir, d'enrober, d'enjoliver : c'est bruyant, métallique, violent, intolérable parfois. Et on en joue, et on en éprouve du plaisir.
Cette ambivalence est la source de l'énergie intense de la musique rock, de sa violence. Contradiction exacerbée, jouée jusque dans ses limites... Et par là-même, le réel s'ouvre et peut se dire au présent : là où l'on est, là où l'on agit, cette réalité ambivalente, contradictoire, c'est-à-dire indéterminée, ouverte à notre action. Réel «irrationnel» donc ? Bien sûr, si le rendre rationnel, c'est l'apaiser, c'est le peupler d'une tranquille certitude, c'est le faire passer dans quelque grande machine théorique à produire des rationalités dominantes. Bien sûr encore, si le rendre irrationnel, c'est faire qu'il cesse d'être nécessaire et qu'il devienne accessible aux prises, aux luttes, aux empoignades (2)».
Qu'il y ait dans le rock jouissance du moderne (machines, violence urbaine...) fait peur. Mais, c'est à condition qu'il apparaisse ambivalent, contradictoire, ouvert qu'il devient possible de présenter, de vivre, de s'approprier le moderne. Irreprésentable, injouable, le moderne n'est plus qu'à fuir, à rêver ou à détruire : fantasme de solutions totales. À distance de telles solutions, mais toujours guetté par elles, le rock renaît et regagne son énergie quand il retrouve cette ambivalence, cette tension par laquelle il nous ouvre à notre présent.
François Maurice
(1) Michel Foucault, article paru dans Le nouvel observateur, 9. mai 1977.
(2) M. Foucault, ibid.
page 31
L'EFFET PUNK
Quelques vérités
D'abord le mot. L'Oxford Dictionary donne la définition suivante: «Punk (US) 1. Bois pourri ; 2. (Argot) : pourri, sans valeur (XVIe siècle, d'origine obscure) ». Pour le Dictionnaire de l'argot américain, le punk est un voyou minable, une petite frappe (ibid). Déchet social, lumpen, minable, détective privé, toute une ambiance. Pour sortir du roman noir, « punk » est un des derniers mots prononcés dans American Graffitti, film sur une certaine jeunesse de la fin des années cinquante aux États-Unis : ici le punk c'est le paumé, celui qui marche toujours à côté de ses pompes. Du voyou au lunaire l'espace punk est grand.
Un mot et une musique : le punk c'est le retour du rock and roll. Une musique qui dès sa naissance, au début des années cinquante, s'est trouvée liée à la jeunesse, ses qualités et ses péchés : protestation sourde, recherche d'identité, éternel conflit de générations, tout ce qu'on veut bien y mettre. Donc, une musique qui ne sera jamais pure musique.
Le punk c'est tout l'héritage du rock urbain, électrifié, primaire, grinçant, sans message ou, s'il existe, secondaire par rapport à l'impulsion issue du volume sonore et de la vitesse. Expression brute.
Les punks fascistes ?
Les punks font peur : les lunettes noires, le cuir, les cheveux ras et ces saletés de croix. Pas peur physique mais peur de la mythologie qu'ils promènent.
Dès leur apparition, les punks ont été traités de fascistes : des gens qui se disent anarchistes, provocateurs, irresponsables sont objectivement des fascistes. C'est la déstabilisation qui commence. Comme en plus ils manipulent les signes du nazisme... Et tous ces thèmes : pas de futur, refus de la théorie, la perversion c'est exactement l'Allemagne des années trente. Avec une vraie crise aussi. S'ils sont lumpen, ou petit-bourgeois, le fascisme est leur seul destin politique. Les punks sont une des manifestations d'une mentalité pré-fasciste. À cela on pourrait opposer les déclarations explicites des chanteurs. Mais quand bien même ils ne diraient rien, c'est une façon un peu rapide d'expédier une mode ; on sait que le fascisme c'est un terme commode qui fait faire l'économie de toute analyse. Sans vouloir faire nous-même l'analyse, il faut soulever quelques points : le pré-fascisme ce n'est pas le fascisme; et le fascisme ce n'est pas que du lumpen et de la bohème petite-bourgeoise qui se rencontrent. Le désespoir, le pessimisme peuvent exister sans pour cela déboucher sur un régime fasciste. Les gens, les jeunes peuvent être désorientés mais il n'y a pas de pente fatale qui conduit à la reconnaissance d'un sauveur ou d'un grand guide. Sauf peut-être le maintien en marge, la non-reconnaissance de certaines révoltes. Et là nous ne parlons pas seulement du punk, mais aussi des loubards, des toxicos, des zonards, le punk n'étant en fait qu'une façon de mettre en scène toutes ces zones d'ombre.
Et la symbolique alors ? Pourquoi les croix ? D'abord une chose : c'est une denrée très rare à se mettre sous les yeux, extrêmement rare, et toujours mise en scène : rapprochée d'autres symboles (badges publicitaires, décorations françaises, etc.) ou transformée (ex. : une croix de fer couleur arc-en-ciel). Laissons parler un vieil aristocrate prussien dans Le Roi des Aulnes (p. 473-474, folio) « Parce qu'alors, le symbole n'étant plus lesté par rien devient maître du ciel. Il prolifère, envahit tout, se brise en mille significations qui ne signifient plus rien du tout... Mais ne cherchez pas à comprendre, c'est-à-dire à trouver pour chaque signe la chose à laquelle il renvoie. Car ces symboles sont diaboles : ils ne symbolisent plus rien. Et de leur saturation naît la fin du monde. » Fin du monde où tout est transparent.
Le refus de la théorie, l'action directe : nouvelle pièce à conviction. Mais n'oublions pas : le punk c'est une musique. Les comptes à régler c'est dans la musique les vieilles stars comme Mick Jagger devenu membre de la jet society, loin de ses révoltes premières, les hippies milliardaires comme l'ancien Beatle George Harrison, tous ceux qui ont voulu faire du rock une chose belle, recherchée, musique pour esthètes, pour gens installés, bien dans leur peau. Les cadres fument des joints et écoutent Pink Floyd. Le refus de la théorie c'est le retour au rock primaire, expression directe d'un état de fait qu'on refuse. La musique punk n'est pas réflexion mais action. Geste plutôt. La musique c'est comme prendre une bière au comptoir, rentrer chez soi par le dernier métro. On ne fait pas la théorie des gestes quotidiens : la musique colle à la peau.
Le punk c'est sympathique parce que c'est le retour du quotidien, l'attention portée au contexte, à ses objets. Plus d'herbe mais de la bière; plus de chemises en soie indienne mais un blouson en synthétique ; plus la campagne mais la banlieue. Le matin en se levant on peut écouter un disque de Clash on ne tombera pas de haut quand on passera le seuil de sa maison. C'est pas la descente après le voyage, c'est le nez au ras du sol. On ne peut plus vraiment mépriser ceux qui travaillent huit heures par jour. Juste se dire que c'est un sale trip, un peu comme le sien.
Ici et maintenant. Entre les utopies et les paniques que ça provoque quand elles échouent. Retour dans la ville, retour au centre du système : la solution n'est pas à côté, ou ailleurs mais ici, avec les faibles moyens, bricolés. Le punk est anti-hippy parce que son univers c’est la grande métropole et pas la campagne, qu'il vit tous les jours les contradictions et les tensions de la société.
Il ne cherche pas à s'échapper. Et le rock c'est la défense, la mise en scène, l'expression. L'électricité et la vitesse contre la musique folk et le rêve de la paix. L'énergie, celle qui part dans tous les sens, incontrôlée contre l'énergie canalisée des yogi.
Finalement le punk ce n'est pas le suicide, c'est l'affrontement. Mettre en scène tout ce qui fascine les inquiets des centres et des périphéries des villes la violence, le fascisme, les paumés.
C'est une idée comme ça : il y a des formes musicales, mineures, qui sont toujours solidaires des révoltes. Le rock en est une et le punk sa manifestation pour la fin des années soixante-dix. Ambiguë certainement. Tant pis. Mais on veut croire qu'il en sortira quelque chose. Et puis en Europe de l'Est ça fait longtemps que le rock accompagne la dissidence.
Patrick Mignon
* Nous publierons prochainement d'autres textes de Patrick Mignon consacrés à ces mêmes questions de la musique rock et de ses formes contemporaines I. Le peuple du rock : des lieux et des objets; Il. Dlsco. Reggae. Punk. New wave les années 77...
page 33
LE SKATE SAUVAGE
On les appelle les « mange-bitume », les piétons volants… ce sont les skateboarders ou les skatistes qui, chevauchant leur planche à roulettes, sillonnent nos trottoirs, nos parkings, nos dalles de béton et offrent le spectacle gratuit de leurs slaloms, de leurs arabesques, de leurs acrobaties... Depuis 1976, le skate connaît en France un véritable boom, comparable à celui de la moto, quoique touchant une génération plus jeune. Lame de fond venue d'Amérique, le skate se répand rapidement en Europe en se servant de l'expérience américaine.
Il y a une quinzaine d'années, sur les côtes californiennes, le skate « émerge » de la mer. Ce sont des surfers en manque de vagues qui vont commencer à mettre au point des planches à roulettes afin de continuer leur sport en bordure de piscines. Le skate est alors un ustensile hybride, peu maniable, constitué d'une petite planche de surf montée sur patins à roulettes. Dans les années soixante, le skate reste dans le sillage du surf qui connaît une vogue grandissante sur les côtes de la Californie. « Cette vogue, écrit Peter Arnold, a même donné naissance à une sorte de culture pop, très en faveur auprès de millions de jeunes. Des groupes pop comme les Beach Boys contribuèrent à attirer l'attention du reste du monde sur ce mode de vie centré sur le soleil, les plages et le surf (1). »
C'est à partir de 1973, avec l'utilisation des roues en polyuréthane assurant une « tenue de route » presque parfaite, que le skate se répand comme une traînée de poudre. En Amérique, il se vend à peu près 800 000 skates par an et plusieurs dizaines de millions de personnes ont pratiqué ou pratiquent le skate. Les stadiums, les pistes se multiplient et parallèlement les exploits, qui révèlent de nouvelles « étoiles », les Bruce Logan, Ty Page, Torget Johnson... aujourd'hui vétérans. En France, l'industrie du skate se porte plutôt bien. Les revues et les ouvrages se répandent. On se sert même du skate comme d'un support publicitaire pour toucher le public « jeune ». À l'évidence le succès du skate souligne, en même temps qu'il essaie d'y remédier, les difficultés de pratiquer le sport dans nos villes, surtout les grandes. À la différence de ses cousins germains, le ski et le surf, qui nécessitent le contact avec la nature, le skate lui tourne le dos et se pratique dans la ville, sur le béton. C'est un sport qui s'épanouit dans l'urbain en offrant au skatiste un panaché de vitesse, d'expression corporelle et de plaisir.
En France, dans une première phase que l'on a pu qualifier de « sauvage» (1976-1977) les skatistes sont partis à la reconquête, pour l'amusement, le défoulement, la communication, d'espaces qui avaient été conçus par les urbanistes pour le passage des piétons ou la décoration de la ville : les trottoirs, les places, les esplanades. Chaque groupe de jeunes se retrouvait dans des spots secrets, endroits se prêtant particulièrement bien à l'entraînement et où il est possible de faire un certain nombre de figures, les mamelons de béton étant particulièrement recherchés par les initiés : le skatiste s'élance d'une bosse, prend de la vitesse et va faire demi-tour, en total déséquilibre, sur une autre bosse, et ainsi de suite. Pour les débutants, le Trocadéro offre l'avantage de ses pistes goudronnées, où l'on peut, une fois les plots disposés, slalomer en douceur.
Le skate apparaît donc comme une tentative de récupération, de détournement ludique des espaces de la ville. Avec le skate, émergent de nouveaux comportements vis-à-vis de l'urbain, en rupture avec les comportements de rejet ou de fuite. Si, pour une partie de la jeunesse, la moto se présente comme une tentative pour échapper, en se marginalisant, à la ville, aux zones de grands ensembles, le skate au contraire peut être considéré comme un mode d'adaptation à l'univers urbain, un essai pour réanimer, pour réenchanter le béton. C'est ainsi qu'un jeune skatiste de 13 ans, en manque de piste, m'a dit, se souciant peu des sensibilités écologiques : « Moi je voudrais que l'on coule le Luxembourg sous le béton, ça ferait une piste formidable ! »
Le skate se présente comme une véritable volonté de transiger avec la ville, d'en faire un monde immédiatement habitable et où l'on puisse trouver un plaisir quotidien. Le skate a révélé en outre un désir d'échanges, de contacts dans l'univers citadin. On fait du skate mais aussi on s’initie. On se communique les «ficelles » de ce nouveau sport et on rompt l'isolement, l'anonymat.
Une autre raison de succès du skate chez les jeunes est que, comme la moto, il comporte des risques, même si c'est à un moindre degré. Il semble que cette prise de risque - calculée, puisque chaque skatiste se soumet à des règles de sécurité très strictes qui le conduisent à se caparaçonner - caractérise, pour le jeune, l'univers du skate contre l'univers sans risque auquel veut le soumettre l'adulte. Le premier reproche que l'on ait fait aux « jeunes » skaters est finalement de vouloir se réapproprier leur vie et la possibilité de la risquer. Phantasme propre aux « materneurs » que nous sommes tous plus ou moins devenus car les accidents les plus fréquents ne sont que des fractures du poignet et du coude. Rien à voir avec les risques que l'on prend en montant dans une voiture ! Non, le skate est simplement un sport difficile qui ne pardonne pas les erreurs, vous éjecte dans un virage… Aussi apprend-on, en même temps que la technique pour tenir sur un skate, l'art d'en tomber. C'est un sport exigeant également une attitude responsable en ce qui concerne la sécurité, pour soi et pour les autres. Avec le skate mais aussi avec la moto réapparaissent des univers d'initiation où s'exprime un âge et où se joue le passage à un autre âge (biologique et social), marqués par des exercices périlleux et aussi par la solidarité, l'entraide, le conflit, la prise de responsabilité.
Le développement actuel du skate en tant que sport met un peu au placard le skate comme phénomène social, comme divertissement, défoulement et communication libres dans la ville. L'initiation, l'apprentissage au lieu d'être directs, spontanés, tendent à se faire de plus en plus à partir d'intermédiaires. Cette normalisation, cette codification du skate s'accompagnent d'un certain nombre de règlements, d'interdits mais aussi d'équipements, de pistes, de stadiums et de clubs réclamés par les jeunes skatistes pour pouvoir s’adonner dans de bonnes conditions à leur sport. Cette nouvelle phase marque un tournant par rapport à l'âge héroïque mais bref du skate sauvage.
Jacques Caroux
(1) Peter Arnold Le Livre du Skateboard, Fernand Nathan, p. 12. |
|